Chikungunya : cette maladie virale transmise par les moustiques

Comment la maladie se transmet-elle ?
Les moustiques, acteurs principaux de la transmission
Le virus du chikungunya est transmis à l’être humain principalement par deux espèces de moustiques tigres : Aedes aegypti et Aedes albopictus. Le premier est originaire des zones tropicales et subtropicales, tandis que le deuxième est désormais implanté en Europe, y compris en France métropolitaine. Ce dernier est capable de survivre à des climats plus frais et urbains, ce qui facilite sa propagation dans des régions initialement non concernées.
Ces deux espèces sont particulièrement dangereuses parce qu’elles piquent pendant la journée augmentant l’exposition et le risque d’infection à la différence du moustique classique qui pique plutôt au crépuscule. Les gestes de prévention sont souvent moins appliqués en journée. De plus, elles vivent à proximité des habitations humaines et pondent dans de petites quantités d’eau stagnante, ce qui rend leur prolifération difficile à contrôler sans une vigilance accrue. Les campagnes de prévention insistent donc sur l'élimination des points d’eau stagnante autour des domiciles.
Les zones géographiques les plus exposées
Certaines zones géographiques sont plus touchées par le chikungunya en raison de la densité des moustiques vecteurs et des conditions climatiques favorables à leur développement. Les régions tropicales et subtropicales comme les Antilles, la Guyane, l’Afrique de l’Est, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique centrale sont historiquement les plus affectées. Cependant, la présence du moustique tigre dans des régions comme le sud de la France, l’Italie ou l’Espagne augmente les risques d’épidémies locales, surtout en été.
Les zones urbaines avec peu de contrôle des déchets, des systèmes d’assainissement défaillants ou une eau stagnante accessible deviennent des terrains idéaux pour la reproduction de ces moustiques. En France, des cas autochtones ont été enregistrés dans le Var, les Alpes-Maritimes ou encore l’Hérault, soulignant la nécessité d’une surveillance épidémiologique continue. Le ministère de la Santé publie régulièrement une carte des départements à risque : voir la surveillance sur Santé publique France (Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France hexagonale 2024).
Prévaésio
Le service de prévention santé
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.
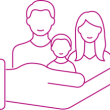
Comment reconnaître le chikungunya ?
Des symptômes caractéristiques
Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 12 jours après la piqûre infectante. La fièvre élevée est souvent le premier signe, suivie rapidement de douleurs articulaires très intenses, qui touchent surtout les poignets, les doigts, les chevilles et les genoux. D’autres signes peuvent apparaître comme des éruptions cutanées, des douleurs musculaires, des maux de tête, une fatigue importante et des nausées. Ces manifestations durent généralement entre 5 et 10 jours, mais les douleurs articulaires peuvent persister plusieurs semaines.
Chez les nourrissons, les personnes âgées ou celles ayant des maladies chroniques, la maladie peut être plus sévère. Même si le taux de mortalité est très faible (environ 1 mort pour 1000 cas), le chikungunya peut provoquer une baisse significative de la qualité de vie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Les formes prolongées et les complications
Dans environ 30 à 40 % des cas, les douleurs articulaires persistent au-delà de trois mois. Ces formes dites prolongées sont souvent comparées à des rhumatismes chroniques. Elles touchent plus fréquemment les personnes âgées ou celles souffrant déjà de troubles articulaires ou auto-immuns. Des études suggèrent que l’infection pourrait déclencher une inflammation persistante des articulations, même après la disparition du virus.
Ces douleurs chroniques peuvent durer jusqu’à deux ans dans les cas les plus sévères. D’autres complications rares, comme des atteintes neurologiques, cardiaques ou hépatiques, ont été décrites, notamment chez les personnes immunodéprimées. La prise en charge repose principalement sur des traitements symptomatiques à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, parfois associés à une rééducation fonctionnelle.
Prévention, recherche et traitement en cours
Les moyens de protection efficaces
Comme il n’existe pas encore de traitement antiviral spécifique, la prévention repose sur la protection contre les piqûres de moustiques. Il est conseillé de porter des vêtements couvrants, d’utiliser des répulsifs adaptés, d’installer des moustiquaires sur les fenêtres et de supprimer toute eau stagnante dans les pots, soucoupes, gouttières et réservoirs autour de la maison. Ces gestes doivent être appliqués de manière rigoureuse, notamment en période estivale et dans les zones infestées.
Le rôle des collectivités territoriales est également essentiel dans la lutte anti-vectorielle, via des campagnes de démoustication et de sensibilisation. En cas de retour de voyage depuis une zone à risque, il est recommandé de consulter votre médecin traitant en cas de symptômes et d’informer les autorités sanitaires en cas de diagnostic confirmé.
aésio mutuelle
Service de consultation médicale à distance
Vous avez des doutes ? Votre médecin traitant n’est pas disponible ? Consultez via Service de consultation médicale à distance
Le chikungunya, une fois diagnostiqué, ne dispose d’aucun traitement antiviral spécifique. La prise en charge repose donc exclusivement sur le soulagement des symptômes. Le repos est essentiel, notamment durant les premiers jours où la fièvre peut être élevée et l’organisme fortement sollicité. Une bonne hydratation est également primordiale afin de prévenir la déshydratation, surtout en cas de forte transpiration liée à la fièvre.
Le paracétamol est généralement recommandé pour faire baisser la fièvre et atténuer les douleurs articulaires. En revanche, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’ibuprofène sont à éviter pendant la phase aiguë. Cela permet d’écarter le risque de complications hémorragiques, en particulier si une confusion est possible avec la dengue, qui circule parfois dans les mêmes zones. Si les douleurs articulaires persistent au-delà de la phase aiguë, des traitements anti-inflammatoires plus doux peuvent être envisagés, mais uniquement après un avis médical.
La recherche d’un vaccin et les perspectives thérapeutiques
La recherche d’un vaccin contre le chikungunya est en cours depuis plusieurs années. Plusieurs laboratoires internationaux, dont des centres français comme l’Institut Pasteur, ont développé des candidats-vaccins, certains étant en phase d’essai clinique avancé. Un vaccin à base de virus atténué développé par Valneva a montré des résultats prometteurs et pourrait être autorisé prochainement par les autorités de santé.
Sur le plan thérapeutique, aucune molécule antivirale spécifique n’est actuellement validée, mais la recherche progresse. Des essais cliniques explorent l’utilisation de certains immunomodulateurs ou antiviraux déjà utilisés pour d’autres virus. En parallèle, les études continuent sur les mécanismes inflammatoires responsables des douleurs prolongées, dans l’espoir de développer des traitements ciblés pour les formes chroniques.
