Microplastiques : une menace invisible pour notre santé et notre environnement

Qu’est-ce qu’un microplastique et comment se forme-t-il ?
Tous les microplastiques n’ont pas la même origine ni la même forme. Certains sont volontairement produits à une taille microscopique, tandis que d’autres résultent de la dégradation progressive de plastiques plus volumineux.
Des microplastiques primaires ou secondaires
Les microplastiques présentent une taille inférieure à 5 millimètres, parfois quelques centaines de nanomètres pour certains d’entre eux (environ 70 fois plus fins qu’un cheveu humain).
Les microplastiques primaires sont fabriqués volontairement par les industriels. On les retrouve par exemple dans certains produits cosmétiques pour leurs propriétés exfoliantes, ou dans des détergents où ils servent à encapsuler des fragrances. Les microbilles de plastique s’invitent également dans des peintures, des encres, des matériaux de construction ou des pelouses artificielles.
Malgré leur petite taille, leur impact environnemental est immense. Ils échappent notamment aux systèmes de filtration classiques et se retrouvent alors directement dans les milieux naturels.
Les microplastiques secondaires, quant à eux, proviennent de la dégradation d’objets en plastique plus volumineux : sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche… Sous l’effet du soleil (photodégradation), de l’abrasion ou simplement du temps, ces plastiques se fragmentent en particules invisibles à l’œil nu. Ces résidus persistent ensuite dans l’environnement, sans jamais disparaître totalement.
Quelle que soit leur origine, ces particules ont en commun le fait d’être non biodégradables, de s’accumuler dans les écosystèmes où ils restent pendant des décennies.
Les principales sources de microplastiques
Les microplastiques proviennent de nombreuses sources présentes dans notre quotidien. Certaines sont visibles, d’autres beaucoup plus discrètes… mais toutes contribuent à cette pollution diffuse.
Bien que progressivement interdits en France et plus largement dans l’Union européenne, certains produits cosmétiques — tels que les gommages, dentifrices ou gels douche — contiennent encore des microbilles de plastique, utilisées pour leurs propriétés exfoliantes ou épaississantes. Ces particules finissent souvent dans les eaux usées sans être retenues par les systèmes de traitement.
Les vêtements en matières synthétiques (polyester, nylon, acrylique…) relâchent des centaines de milliers de microfibres plastiques dans l’eau à chaque lavage. Trop fines pour être filtrées, ces fibres rejoignent ensuite les milieux aquatiques via le réseau d’assainissement.
Le secteur des transports est également impliqué. L’usure des pneus en roulant entraîne la dispersion de particules plastiques dans l’air et sur la chaussée : entraînées par la pluie, elles se retrouvent finalement dans les rivières et les océans. Ce phénomène, longtemps sous-estimé, représente pourtant une part majeure de la pollution microplastique en milieu urbain. Les peintures utilisées pour le marquage routier peuvent aussi contenir des microparticules de plastique.
Abandonnés dans la nature, les emballages plastiques — sacs, bouteilles, boîtes alimentaires… — se dégradent lentement sous l’effet du soleil et du vent. Ce processus produit des microplastiques secondaires, capables de persister dans l’environnement pendant plusieurs décennies.
Ces exemples offrent un aperçu de la diversité des sources de pollution, mais ne constituent en réalité que la partie émergée de l’iceberg. De nombreux produits et procédés industriels génèrent également des microplastiques, parfois à notre insu.
Prévaésio
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.
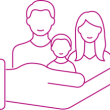
Où retrouve-t-on les microplastiques au quotidien ?
De la surface des océans jusqu’à l’intérieur de notre corps, les microplastiques sont désormais partout. Invisibles, ils n’en sont pas moins présents dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons ou les aliments que nous consommons. Et leur concentration ne cesse d’augmenter.
Une omniprésence des microplastiques dans les rivières et les océans
Les cours d’eau sont les premiers réceptacles des particules plastiques :
Rejetées dans les égouts, ces particules ne sont pas forcément interceptées par les stations d’épuration, dont les technologies, parfois inadaptées ou obsolètes, ne permettent pas de filtrer les particules les plus fines.
Provenant de déchets abandonnés dans la nature, elles sont entraînées par les eaux de ruissellement vers les ruisseaux ou les rivières.
Transportés par les cours d’eau, ces résidus atteignent les mers et les océans, où ils s’accumulent, parfois à des milliers de kilomètres de leur point d’émission. Des chercheurs de l’Université d’Auckland estiment ainsi, dans une étude publiée en 2023 dans PLOS One, que les océans contiendraient aujourd’hui plus de 170 000 milliards de particules de plastique.
L’eau potable elle-même n’échappe pas à cette contamination. Dans une étude parue en 2025 dans la revue PLOS Water, des chercheurs du CNRS et de l’Université de Toulouse ont analysé dix marques d’eau en bouteille vendues en France ainsi qu’un échantillon d’eau du robinet prélevé à Toulouse : tous les échantillons contenaient des microplastiques, avec des concentrations allant de 19 à 1 154 particules par litre (MPs/L). Plus préoccupant encore : cette même étude révèle que près de 98 % des microparticules de plastique présentes dans l’eau échappent aux méthodes de détection actuelles, en raison de leur taille extrêmement réduite — souvent inférieure à 20 micromètres, soit bien en dessous du seuil fixé par la directive européenne en vigueur.
Une pollution de l’air et des sols moins visible mais bien réelle
La présence de plastiques dans les océans fait l’objet de nombreuses campagnes de sensibilisation, et nous sommes désormais largement avertis de cette pollution. En revanche, la contamination de l’air et des sols reste encore largement méconnue.
Dans l’atmosphère, les microplastiques circulent à travers les vents, les poussières - notamment en zone urbaine - et même des précipitations. Des études ont par exemple révélé leur présence dans des zones éloignées de toute activité humaine, y compris dans les Alpes, preuve de leur capacité à voyager sur de très longues distances.
L’air intérieur de nos logements est également concerné. Une étude australienne publiée en 2022 a analysé des échantillons de poussière issus de 108 foyers dans 29 pays différents : tous présentaient une contamination par des microplastiques, issus notamment des textiles, des mousses et des revêtements synthétiques.
Si l’air est touché, les sols agricoles ne sont pas non plus épargnés. L’utilisation de boues issues des stations d’épuration comme fertilisants, ainsi que les déchets plastiques transportés par le vent ou l’eau de ruissellement, sont autant de sources de pollution durable. Selon l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), les quantités de microplastiques présentes dans les sols européens pourraient être plus importantes que celles retrouvées dans les océans.
Une alimentation parfois chargée en microplastiques
Les microplastiques s’invitent aussi dans nos assiettes. De nombreux aliments ont été identifiés comme porteurs de microparticules plastiques, en raison de la pollution de leur environnement de production ou de leur conditionnement.
Les produits de la mer sont particulièrement concernés : les coquillages et crustacés filtrent l’eau de mer et concentrent ainsi les microplastiques présents dans leur habitat. En les consommant entiers, nous ingérons directement ces particules. Les huîtres, les moules et les coquilles Saint-Jacques sont les plus touchées par cette contamination selon une étude parue en 2020 dans Springer Nature Link.
Mais la présence de microparticules dans votre alimentation peut aussi venir des emballages. Certains plastiques alimentaires, notamment ceux utilisés pour les barquettes, sachets ou films protecteurs, libèrent des microparticules au contact de la chaleur, des graisses ou d’un environnement acide.
Les fruits, les légumes, les viandes ne sont pas épargnés non plus : une étude menée en 2024 par des chercheurs de l’université de Toronto a mis en évidence la présence de microplastiques dans 88 % des échantillons de viande et de substituts protéiques végétaux analysés.
Eau du robinet ou eau en bouteille : laquelle privilégier ?
L’eau en bouteille est souvent perçue comme plus pure ou meilleure pour la santé que celle du robinet. Pourtant, des recherches montrent qu’elle peut contenir autant, voire davantage de microplastiques que l’eau du réseau.
L’eau en bouteille génère par ailleurs une pollution plastique supplémentaire, liée à sa production, à son transport et à ses déchets. Dans bien des cas, boire l’eau du robinet - filtrée ou non - constitue une alternative plus économique et plus écologique.
Comment limiter notre exposition aux microplastiques ?
L’exposition aux microplastiques est aujourd’hui avérée, mais leurs effets à long terme restent encore mal connus. S’ils sont présents partout – dans l’air, l’eau, les sols et l’alimentation – leur toxicité dépend de leur taille, de leur composition, de leur durée de contact avec l’organisme, mais aussi des substances chimiques qu’ils transportent.
Des effets avérés ou suspectés sur l’organisme
Les microplastiques peuvent pénétrer dans le corps humain par ingestion, inhalation ou contact cutané, et nous sommes tous concernés. Une étude néerlandaise publiée en 2022 a ainsi mis en évidence la présence de ces particules dans le sang de 22 volontaires, tandis qu’une autre étude britannique parue elle aussi en 2022, a souligné la présence de microparticules en grand nombre dans les poumons.
Si la contamination humaine est incontestable, les scientifiques ne s’accordent pas encore sur les risques sanitaires associés. Leurs inquiétudes portent sur différents effets potentiels, liés à la présence de particules et à leur composition :
Des inflammations chroniques ;
Un stress oxydatif ;
Des risques accrus de maladies cardiovasculaires ;
Inflammation chronique ;
Perturbations endocriniennes ;
Problèmes intestinaux ;
etc.
Des recherches sont également en cours pour évaluer leur potentiel rôle dans certains cancers.
Certaines populations sont plus à risque, telles que les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes vivant en milieu urbain.
En attendant des données scientifiques définitives, le principe de précaution s’impose : limiter notre exposition est un choix responsable, tant pour notre santé que pour celle des écosystèmes. Nous pouvons agir collectivement pour limiter la contamination de l’environnement par les microplastiques, et modifier nos habitudes pour réduire notre exposition individuelle.
AÉSIO mutuelle
Obtenez rapidement et gratuitement un deuxième avis médical sur plus de 700 pathologies
Le service Deuxième Avis d’AÉSIO mutuelle vous permet de consulter un médecin expert, en toute confidentialité, pour obtenir un éclairage complémentaire sur votre pathologie.
Agir collectivement pour réduire les microplastiques
Face à l’ampleur du phénomène, les réponses doivent être collectives.
La mise en place de réglementations plus strictes, à l’échelle nationale comme européenne, est essentielle. La stratégie européenne sur les plastiques, adoptée en 2018, vise par exemple à réduire l’usage des plastiques à usage unique, à promouvoir le recyclage et à encourager l’écoconception des produits.
L’innovation joue également un rôle clé, avec le développement de matériaux d’origine végétale, biodégradables ou recyclables, moins polluants et mieux intégrés à une logique d’économie circulaire.
À côté de ces grandes orientations politiques et industrielles, les actions citoyennes et associatives contribuent elles aussi à faire bouger les lignes. Vous pouvez agir en soutenant financièrement des projets de dépollution ou de sensibilisation, en participant à des opérations de ramassage des déchets dans la nature ou en rejoignant des associations locales ou des ONG impliquées dans ce combat.
Chaque action, même modeste, participe à une dynamique de changement. Ensemble, nous pouvons freiner la pollution plastique à la source.
Les gestes individuels pour se protéger au quotidien
Réduire notre exposition aux microplastiques passe aussi par des choix personnels, à la maison, dans nos habitudes de consommation ou d’entretien.
Une consommation plus responsable est la clé pour réduire votre exposition et votre impact :
Remplacez les contenants en plastique tels que les bouteilles ou les boîtes hermétiques par des solutions équivalentes dans un matériau plus durable, en verre ou en inox ;
Privilégiez les vêtements en fibres naturelles (coton, lin, laine, etc.) ;
Évitez les produits alimentaires emballés dans du plastique, notamment les produits gras ou acides ;
Préférez le thé en vrac ou en sachets compostables aux thés en sachets en nylon ou en plastique ;
Vous pouvez aussi diminuer la teneur en microplastiques de votre logement avec ces quelques gestes simples :
Aérez régulièrement votre logement ;
Utilisez un chiffon humide plutôt qu’un plumeau sec, susceptible de disperser la poussière ;
Optez pour un aspirateur avec filtre HEPA qui capture les particules les plus fines.
Pour aller plus loin, découvrez comment chaque territoire s’engage en faveur de la santé environnementale en 2025, et explorez les actions de prévention et de promotion de la santé proposées par AÉSIO mutuelle.

