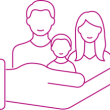Comprendre et prévenir la sécheresse vaginale

Quels sont les effets et les complications de la sécheresse vaginale ?
La principale gêne est ressentie à l’occasion des rapports sexuels, avec une douleur et une sensation de brûlure lors de l’acte. Certaines femmes ressentent des démangeaisons, une sensation d’échauffement, des irritations au niveau du vagin et des organes génitaux externes (vulve et clitoris). L’inconfort peut également être présent au moment d’uriner ou de s’essuyer.
La sécheresse intime fragilise les muqueuses vaginales, pouvant perturber l’équilibre de la flore et favoriser la prolifération de bactéries ou de mycoses. La proximité avec l'urètre peut favoriser des infections urinaires, telles que les cystites, ou provoquer des mictions douloureuses.
Lorsqu’elle persiste, la sécheresse vaginale peut entraîner une perte d’élasticité et un amincissement des parois du vagin. Des fissures peuvent également apparaître, avec des douleurs, des saignements, des inflammations et des risques infectieux.
Les conséquences d’une sécheresse vaginale sont également psychologiques. Les douleurs ressenties lors des rapports sexuels peuvent avoir un impact direct sur la vie intime et relationnelle des femmes qui en souffrent.
Pourquoi certaines femmes souffrent-elles de sécheresse intime ?
Plusieurs glandes produisent du mucus vaginal afin de maintenir une hydratation optimale :
Les glandes de Bartholin, situées à l’entrée de l’orifice vaginal ;
Les glandes de Skene, situées autour de l’urètre ;
Les glandes cervicales, influencées par les œstrogènes, jouent un rôle secondaire dans la lubrification en dehors des périodes fertiles ;
Les tissus des parois vaginales, par production de transsudat vaginal lors de l’excitation sexuelle.
La sécheresse vaginale survient lorsque ces mécanismes de lubrification naturelle présentent des dysfonctionnements.
Les déséquilibres hormonaux, notamment une diminution du taux d’œstrogènes, sont souvent à l'origine de ce phénomène. Ils se manifestent particulièrement pendant la grossesse, le post-partum, l’allaitement ou la ménopause.
Certaines infections, favorisées par le port de vêtements trop serrés ou par une hygiène intime excessive qui altère la flore vaginale, ou encore par une irritation, peuvent également être à l'origine d’une diminution de la production de mucus vaginal.
Des maladies auto-immunes, telles que le syndrome de Gougerot-Sjögren qui affecte les glandes exocrines, peuvent altérer le fonctionnement des glandes productrices de mucus.
Des médicaments peuvent inclure dans leurs effets indésirables une sécheresse intime. C’est notamment le cas de certains traitements prescrits contre l’infertilité, le cancer (notamment le cancer du sein), l’hypotension, les fibromes, les allergies (antihistaminiques) ou la dépression. La sécheresse intime est parfois consécutive à un acte chirurgical tel qu’une hystérectomie.
Certaines causes psychologiques, telles que le stress intense ou de fortes tensions avec son partenaire, sont également avancées.
Quand consulter en cas de sécheresse vaginale ?
Vous devez en parler à votre médecin traitant ou à votre gynécologue si la gêne devient permanente ou impacte votre vie intime. Vous devez également consulter si :
La douleur pendant les rapports sexuels devient permanente ;
Vous subissez des infections urinaires à répétition ;
Vous êtes confrontée à une mycose ou à une vaginose bactérienne récurrente ;
Vous constatez des saignements vaginaux inhabituels.
Connaître les remboursements chez votre médecin traitant et votre gynécologue.
Le diagnostic débute généralement par un interrogatoire sur les symptômes, l’historique médical et hormonal, les habitudes de vie et la présence de facteurs aggravants.
Un examen clinique, pouvant inclure une évaluation du pH vaginal et une recherche d’infections éventuelles, permet d’évaluer l’état des muqueuses et d'identifier d’éventuelles anomalies. Cet examen peut être complété par un frottis vaginal, un bilan sanguin avec dosage hormonal ou plus rarement par une biopsie.
Comment traiter la sécheresse vaginale ?
Le traitement dépend de la cause identifiée par le professionnel de santé.
Certains lubrifiants en application locale, sous la forme de gel ou d’ovules, offrent un meilleur confort pendant les relations sexuelles.
Un traitement hormonal substitutif, souvent à faible dose et local (crèmes ou ovules), peut être proposé aux femmes ménopausées. Ce traitement ne convient pas à toutes les patientes, il est notamment contre-indiqué en cas d'antécédent de cancer hormono-dépendant. Il est prescrit après une évaluation rigoureuse des bénéfices et des risques par le médecin.
Une modification de certaines habitudes de vie peut également être bénéfique. Une consommation excessive de tabac et d’alcool peut indirectement altérer la lubrification intime, en perturbant la vascularisation et, dans le cas du tabac, la production d’hormones.
Quelle prise en charge pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse vaginale ?
Les consultations chez le médecin traitant et le gynécologue sont prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire. Le ticket modérateur peut quant à lui être remboursé par la complémentaire santé, selon les garanties prévues par votre contrat. Le respect du parcours de soins coordonnés permet de bénéficier des meilleurs taux de remboursement, selon votre couverture. Notez également que les professionnels de santé exerçant en secteur 2 ou non conventionnés peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires : votre couverture complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie de ces dépassements.
Vous avez des questions sur la prise en charge de vos soins médicaux ? Vous pouvez contacter votre caisse primaire d’assurance maladie ou votre complémentaire pour avoir des informations supplémentaires.
Faisons un point ensemble sur vos besoins, pour déterminer la couverture santé qui répond à l'ensemble de vos besoins !
Prévaésio
Le service de prévention santé
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.