Quels sont les bienfaits de la nature sur notre santé ?
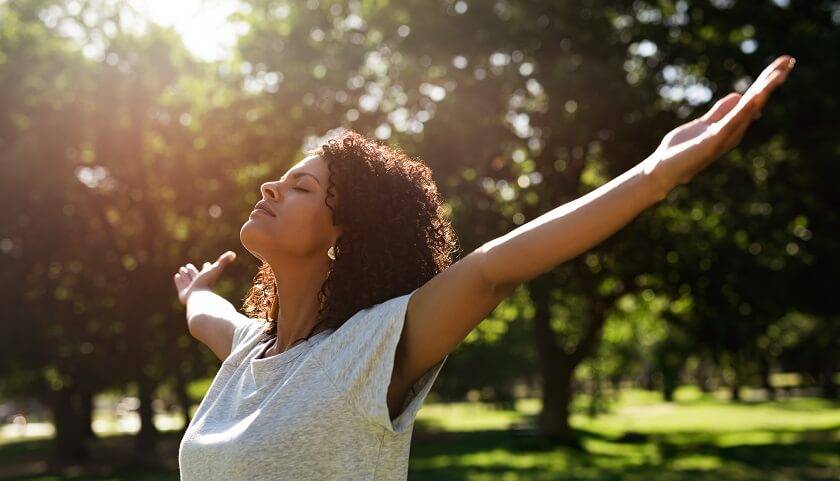
Une exposition à la nature qui nous fait du bien
Alors que les bouleversements sociaux et environnementaux ne cessent d’alimenter l’actualité, il est établi dans l’esprit d’une majorité de Français que la nature exerce un impact psychologique réel avec une influence positive sur le bien-être.
Cette intuition se vérifie aujourd’hui dans de nombreuses études publiées sur le sujet. Des expériences sont menées en forêt, au contact des arbres, ou dans tout autre espace vert ou naturel : au milieu des champs, et même dans un parc ou un jardin public.
Ainsi, il est établi que respirer les effluves de pin est bon pour la santé : les phytoncides (aérosols forestiers) sont antioxydants, antiseptiques et immuno-stimulants. Même constat pour une promenade en bord de mer où les ions négatifs présents ont un impact positif sur la santé physique et émotionnelle. Ils favorisent même la bonne humeur ! Et ces bienfaits se constatent aussi durant la saison froide : les Scandinaves ont même inventé le concept de “friluftsliv” pour désigner les bienfaits du grand air en hiver !
Ces travaux sont corroborés par des recherches en médecine, psychologie, sciences cognitives… comme par exemple l’enquête menée par le cabinet d’étude OpinionWay en 2015.
Les Français partagent globalement le même avis sur ce qu’est la nature, et 96% d’entre eux la considèrent avant tout comme un lieu de bien-être et de ressourcement.
(source OpinionWay)
La nature sous toutes ses formes
Le mot "nature" recouvre des espaces très variés : on pense spontanément à la campagne et à la forêt, à la faune et à la flore, à la montagne, à la mer, et à toutes les composantes qui agissent au sein de nos écosystèmes.
S’il est ici question de "pleine nature", ses bienfaits ne sont pas absents des milieux urbains : en ville, les espaces verts, parcs, bois et jardins jouent un rôle important dans le bien-être des citadins.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy¹ a notamment démontré les effets bénéfiques de son jardin thérapeutique sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer : autonomie accrue, amélioration des capacités cognitives, de l’appétit et du sommeil, réduction de l’agressivité et de l’agitation...
Quels sont les effets positifs sur notre santé mentale ?
Une exposition même courte à la nature porte déjà ses fruits sur la santé mentale. Un rapport publié dans Nature en 2019 a ainsi démontré que deux heures par semaine suffisent pour améliorer votre état de santé et votre bien-être. Ce contact a un effet relaxant qui diminue le stress et les risques de dépression et d’anxiété, tout en améliorant votre concentration, votre niveau d’attention et vos capacités d’apprentissage. Une autre étude scientifique de l'université du Michigan dirigée par MaryCarol Hunter a montré qu’une exposition de seulement 20 minutes en pleine nature suffit pour permettre une diminution du taux de cortisol, avec ou sans activité physique.

© photo T.Anunziata sur Pexels
Le concept de biophilie établi en 1984 par le biologiste Edward O. Wilson, est une explication possible à ce phénomène : il suppose que les humains ont une tendance innée à rechercher des liens avec la nature et avec les autres êtres vivants.
Il est donc temps, plus que jamais, de se réconcilier avec la nature et d’agir pour la préserver !
La nature et les bienfaits de l’activité physique
La proximité de la nature incite également à pratiquer régulièrement une activité : une étude portant sur 8 pays a montré que les personnes qui habitent à moins d’un kilomètre de jardins publics ou de parcs sont en moyenne 24 minutes plus actives par semaine que les autres, ce qui représente un sixième de l’activité physique hebdomadaire recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé. Or l’activité physique est essentielle à une prévention de l’obésité et des risques cardiovasculaires.
Différentes études scientifiques menées ces dernières années, comme les études Elsevier², démontrent qu’une marche en forêt d’une vingtaine de minutes (sylvothérapie) a des effets bénéfiques sur la rigidité des artères et la fonction respiratoire. D’autres mettent en évidence des changements favorables de molécules pro-inflammatoires chez des patients souffrant d’hypertension artérielle, avec une baisse durable de la tension artérielle.
Les vertus thérapeutiques de la nature sont donc nombreuses. Au-delà de la détente et du repos qu’elle procure, elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre la douleur, certaines maladies ou, encore, dans le traitement de l’obésité.
AÉSIO mutuelle
Assurance loisirs : être mieux protégé au quotidien
AÉSIO mutuelle vous protège en cas d'accidents de loisirs : activités sportives, voyages, sorties entre amis…
Les "bains de forêt" ou shinrin yoku
Au Japon, une pratique consiste à se rapprocher de la nature en sollicitant ses 5 sens, pour se dédier au moment présent.
Ces promenades méditatives en forêt, accompagnées d’exercices physiques et de respiration sous les directives d’un guide spécialisé, ont pour but d’améliorer l’humeur et d’apaiser les troubles du comportement tels que l’anxiété, la dépression, l’agressivité et la fatigue.
AÉSIO mutuelle
Quand consulter un psychologue ?
Si vous ressentez des difficultés passagères, du stress ou de l’anxiété, si vous traversez une période de mal-être, un suivi psychologique peut être utile ou nécessaire. L’Assurance Maladie Obligatoire peut-elle vous rembourser ces séances ? Comment diminuer vos frais de santé ? AÉSIO mutuelle vous oriente pour trouver des solutions adaptées.
Faites entrer la nature chez vous
Vous n’habitez pas à proximité d’un parc, d’une forêt ou de la campagne ? Vous pouvez accueillir des végétaux dans votre logement, sur votre balcon ou votre terrasse. Les bienfaits des plantes d’intérieur sont nombreux, au domicile comme au travail :
- Elles assainissent et humidifient l’air ambiant ;
- Elles contribuent à un sentiment de bien-être.
-------------
¹ Dossier de presse Jardin Art, mémoire et vie du CHRU de Nancy, site internet du CHRU de Nancy.
² Étude Elsevier 2015 sur les liens entre la nature, la biodiversité, les services écosystémiques et la santé et le bien-être humains ; Étude Elsevier 2018 sur la relation entre le temps passé à l'extérieur et le stress.
Sur le même sujet
Éco-anxiété : comment la surmonter ?
Incendies de Los Angeles, inondations en Espagne, accélération de la fonte des glaciers, épisodes de sécheresse à répétition… Le changement climatique est une réalité sévissant dans le monde entier. Chez certains, la crise écologique peut générer une véritable angoisse qui porte un nom : l’éco-anxiété. Loin d’être une fatalité, cette anxiété n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Comment y faire face ?

Il est clair que l’on assiste à une véritable explosion de pathologies telles que des cancers et des maladies neuro-dégénératives directement liées à la dégradation de notre environnement. ”
Entretien avec Corinne LEPAGE
Ancienne ministre de l’Environnement, avocate et présidente de Cap 21
– En 2004, vous avez publié "Santé et environnement, l’ABCédaire", qui évoque les interactions entre notre santé et la détérioration de notre environnement. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Corinne Lepage - Vingt ans plus tard, ces questions sont toujours d’actualité. Certes, il y a eu des avancées importantes ces dernières années. À titre d’exemple, on ne parlait pas de certaines substances comme le formaldéhyde que l’on retrouve dans les produits de bricolage, d'entretien, dans les revêtements de murs, dans les plastiques… Aujourd’hui, ce sont des composants interdits. En revanche, d’autres restent toujours présents dans des produits du quotidien.
Il est clair que l’on assiste à une véritable explosion de pathologies telles que des cancers et des maladies neuro-dégénératives directement liées à la dégradation de notre environnement. C’est très vrai pour les agriculteurs, mais aussi pour les personnes vivant près des zones où sont opérés des épandages. Mais la pollution agricole n’est pas la seule, nos industries restent globalement très polluantes.
– Des études établissent un lien certain entre une bonne santé et le fait de vivre plus proche de la nature. Pensez-vous qu’on en soit suffisamment conscients aujourd’hui ?
CL - La prise de conscience des citoyens [lien] n’est pas nouvelle. Les médias spécialisés et les actions des associations qui militent en faveur de l’environnement ont fait un important travail qui, peu à peu, porte ses fruits. La crise sanitaire a également mis en évidence l’importance des bienfaits de la campagne et du bord de mer. Ceux qui ont pu se réfugier « au vert » ont beaucoup moins souffert du confinement et redécouvert, assurément, les vertus des promenades champêtres et de l’anti-stress que représente le contact avec la nature.
D’un autre côté, après l’engouement pour les produits bio, on constate aujourd’hui un recul de leur consommation dû à la suspicion des consommateurs qui ne savent plus très bien à quoi correspondent les labels affichés par la grande distribution. Il est temps de mettre de l’ordre dans tout cela !
– Un phénomène d’éco-anxiété semble se développer, notamment à la suite de la parution du dernier rapport du GIEC. Qu’en pensez-vous ?
CL - Cette éco-anxiété porte aussi le nom de solastalgie, un concept inventé en 2003 par le philosophe australien spécialiste de l'environnement Glenn Albrecht. C’est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée, par exemple, par les changements environnementaux passés, actuels et attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la biodiversité.
Cette angoisse est fondée en cette période de transition vers un nouveau monde qui n’est pas encore établi.
Pour autant, il faut croire en l’avenir et en la possibilité de trouver des solutions. Elles peuvent être individuelles et collectives et, en ce sens, la recherche du bien-être en lien avec la nature a un rôle clé à jouer. Toutes les initiatives dans ce domaine sont bonnes à prendre !







