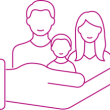Prééclampsie : comment protéger maman et bébé ?

Prééclampsie, une maladie de la grossesse
La prééclampsie survient à partir du deuxième trimestre de grossesse (20e semaine d’aménorrhée) ou, dans certains cas, avant ou juste après l’accouchement. Elle résulte d’un dysfonctionnement du placenta. Cet organe temporaire se forme dans l’utérus pendant la grossesse, et permet les échanges sanguins entre la mère et le fœtus.
La prééclampsie, autrefois appelée « toxémie gravidique », est causée par une malformation des vaisseaux sanguins du placenta. Cette anomalie a des répercussions sur la croissance du fœtus et sur le fonctionnement de l’organisme de la mère. Celle-ci est alors sujette à l’association :
D’une pression artérielle élevée (pression artérielle systolique > 140 mmHg et pression artérielle diastolique > 90 mmHG). On parle alors d’hypertension gravidique ou gestationnelle ;
D’une augmentation de la quantité de protéines dans ses urines ou protéinurie (concentration de protéines dans les urines > 300 mg/24h).
Parfois ces deux symptômes maternels sont accompagnés d’un œdème pulmonaire ou d’un dysfonctionnement du foie ou des reins.
La prééclampsie est observée dans 3 à 5 % des grossesses. Aujourd’hui, un suivi de la mère enceinte permet de réduire à 1 % les risques de survenue d’une forme sévère : la crise d’éclampsie.
Les facteurs de risques de la prééclampsie
La prééclampsie survient généralement lors de la première grossesse (70 à 75 % des cas). Les risques les plus élevés de prééclampsie sont généralement identifiés chez les femmes enceintes :
Âgées de moins de 18 ans ou de plus de 40 ans ;
Ayant des antécédents de prééclampsie ou des antécédents familiaux de prééclampsie ;
De plusieurs bébés (grossesse multiple : jumeaux, triplés, etc.).
Elle peut survenir aussi chez les femmes qui ont connu un changement récent de partenaire sexuel ou qui ont peu été exposées au sperme de leur partenaire (port prolongé du préservatif). La prééclampsie est aussi davantage présente lors d’une procréation médicalement assistée avec don de sperme. Ce facteur de risque repose sur l’hypothèse d’une réaction immunitaire déclenchée par l’exposition aux antigènes du père.
Les risques de prééclampsie sont augmentés si, avant la grossesse, la maman est affectée par :
Un diabète, une hypertension artérielle, une maladie rénale ou une obésité (indice de masse corporel > 30) ;
Un syndrome des ovaires polykystiques ;
Une maladie auto-immune (lupus, syndrome des antiphospholipides, sclérose en plaques).
Des symptômes variant d’une femme à l’autre
La prééclampsie ne provoque pas toujours de symptômes. Souvent la prééclampsie est identifiée lors des consultations mensuelles de suivi de grossesse. Pendant ces visites, la prise de la tension et le recueil des urines permettent de déceler une hypertension et une protéinurie.
Toutefois, en cas de prééclampsie sévère, la femme enceinte peut ressentir divers symptômes tels que des maux de tête intenses, des troubles de la vision (tâches noires ou lumineuses défilant dans le champ de vision), des acouphènes, des douleurs abdominales (sous les côtes droites), des vomissements ou encore la diminution voire, l’arrêt des urines. Enfin, des œdèmes peuvent apparaître chez certaines femmes au niveau du visage ou des membres ; ils s’accompagnent souvent d’une prise de poids brutale (plusieurs kilos en quelques jours).
Après l’apparition des premiers symptômes, la prééclampsie peut évoluer rapidement, notamment au troisième trimestre de grossesse. Une prise en charge immédiate est donc nécessaire.
L’importance du suivi de la grossesse pour le diagnostic
Outre la prise de la tension et l’analyse des urines réalisées à chaque visite mensuelle, trois échographies sont recommandées au cours d’une grossesse sans risque. Le dépistage de la prééclampsie est aussi réalisé lors de la première échographie du premier trimestre (entre la 11e et la 13e semaine d’aménorrhée).
En cas de signes d’alerte, la femme enceinte est hospitalisée d’urgence afin d’évaluer la sévérité de la prééclampsie et la vitalité du fœtus.
AÉSIO mutuelle
Quels remboursements chez le gynécologue ?
Découvrez combien vous pouvez économiser sur vos consultations gynécologiques. Cliquez ici pour en savoir plus !
Des risques de complications maternelles et fœtales
En France, la prééclampsie reste l’une des principales causes de décès maternel et fœtal. Ce risque extrême est cependant rare, grâce à une prise en charge et un suivi étroit de la femme enceinte. Toutefois, un cas sur 10 de prééclampsie est sévère.
Lorsqu’une prééclampsie sévère est décelée avant 26 semaines d’aménorrhée, une interruption médicale de grossesse est envisagée afin de protéger la mère ; le fœtus (viable ou non) et le placenta sont extraits.
Chez la mère, une prééclampsie non traitée peut conduire à une éclampsie. Celle-ci se manifeste en fin de grossesse ou après l’accouchement par la survenue de crises convulsives affectant le cerveau de la mère.
Une prééclampsie peut également être à l’origine d’autres complications chez la mère :
Un hématome rétroplacentaire provoquant un décollement du placenta ;
Le syndrome HELLP (destruction prématurée des globules rouges, diminution du nombre de plaquettes sanguines, augmentation des enzymes hépatiques) à l’origine d’hématomes autour du foie.
Des complications plus rares sont observées chez les femmes atteintes de prééclampsie : accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale aiguë, rupture hémorragique du foie, œdème aigu du poumon, décollement de la rétine, etc.
Pour le fœtus, la prééclampsie est une cause majeure de retard de croissance pendant la grossesse (intra-utérin). En cas de retard important, un accouchement avant le terme est envisagé. La prématurité est alors l’une des complications d’une prééclampsie. Ce syndrome est à l’origine d’un tiers des naissances de grands prématurés en France.
Très rarement aujourd’hui, le fœtus peut décéder en cas de crise d’éclampsie ou d’hématome rétroplacentaire important survenant brutalement.
L’hospitalisation pour traiter et prévenir la prééclampsie
L’accouchement est le seul moyen de mettre fin à la prééclampsie et à une hypertension gravidique.
En cas de prééclampsie, une hospitalisation est indispensable. Elle permet une surveillance continue de la grossesse. Ce suivi inclut l’évaluation de la gravité de la prééclampsie pour la mère et la mesure du retentissement de la maladie sur le fœtus. L’objectif de cette prise en charge est de prolonger le plus longtemps possible la grossesse. L’enfant peut alors poursuivre son développement et les risques sur sa santé et celle de la maman sont nettement diminués.
Cette hospitalisation peut être de courte durée en cas d’hypertension artérielle ou de prééclampsie sans complication. La patiente peut ensuite rester à domicile mais doit être alitée. Un antihypertenseur lui est administré pour l'hypertension artérielle gravidique. Un traitement par corticoïdes injectables est envisagé pour accélérer le développement des poumons du fœtus.
En cas de prééclampsie sévère, la femme enceinte reste hospitalisée. Un accouchement prématuré par césarienne est réalisé à la moindre complication.
Chez les femmes qui ont un antécédent de prééclampsie, un traitement préventif par aspirine à faible dose peut être prescrit avant la 16e semaine d’aménorrhée.
AÉSIO mutuelle
Quelle prise en charge de vos frais d’hospitalisation ?
Cliquez ici pour en savoir plus sur les garanties qui peuvent alléger vos frais d'hospitalisation.
Prévenir la prééclampsie avant une grossesse
En cas de désir d’enfant, les femmes qui ont une hypertension artérielle, un diabète, une surcharge pondérale doivent consulter leur médecin traitant. Elles recevront alors une prise en charge adaptée (contrôle de la tension artérielle avant la grossesse, suivi médical régulier, etc.) permettant de limiter les risques d’apparition d’une prééclampsie.
Prévaésio
Le service de prévention santé
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.