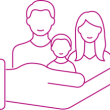Le lymphœdème : causes et traitements

Le système lymphatique, un réseau vital aux multiples fonctions
Il joue un rôle fondamental dans la défense immunitaire grâce au transport de lymphocytes, une catégorie de globules blancs qui luttent contre les infections. Il contribue aussi à la circulation des nutriments et des hormones.
Ses vaisseaux unidirectionnels se déploient dans les différents tissus de notre organisme. Ils transportent la lymphe. Ce liquide clair contenant des lymphocytes, est filtré par les ganglions lymphatiques concentrés principalement sous la peau au niveau du cou, de l’aine et sous les bras. Ces minuscules organes sont considérés comme une sorte de « station d’épuration ».
La circulation de la lymphe résulte de la respiration et des mouvements de nos muscles. Lors d’une activité physique ou de mouvements du corps plus intense, la circulation de la lymphe est plus rapide. Une immobilité prolongée peut toutefois entraver le drainage de la lymphe.
Lymphœdème, de quoi parle-t-on ?
Un lymphœdème est une affection qui provoque le gonflement durable des tissus. Il résulte d’une anomalie qui gêne la circulation de la lymphe. Ce liquide s’accumule alors dans les tissus sous-cutanés et provoque une augmentation du volume du membre affecté. Il se développe généralement dans un bras, une jambe ou, plus rarement, les organes génitaux, le visage, le cou ou le tronc. Son étendue est variable ; il peut, par exemple, être limité à la main, à l’avant-bras ou au bras entier.
S’il n’est pas pris en charge, le lymphœdème peut engendrer des complications. Un certain handicap peut gêner votre quotidien. Votre qualité de vie et votre santé mentale peuvent être affectées. Et le risque d’érysipèle, une infection de la peau, est fréquent.
Lymphœdème primaire et lymphœdème secondaire, quelle différence ?
Le lymphœdème primaire est dû à une malformation congénitale (présente à la naissance) qui affecte le système lymphatique. Classé dans les maladies rares et orphelines, il est lié à une quantité insuffisante (hypoplasie) ou à une absence (aplasie) de vaisseaux lymphatiques dans certains membres. Il affecte généralement les jambes, les organes génitaux ou, plus rarement, les intestins.
Le lymphœdème secondaire est le plus fréquent. Il résulte de lésions du système lymphatique qui bloquent partiellement la circulation de la lymphe. Il peut survenir après une opération chirurgicale (ablation de ganglions lymphatiques, par exemple), un traumatisme (blessure grave, brûlure), une infection ou une radiothérapie (traitement d’un cancer). L’obésité ou l’insuffisance veineuse chronique peuvent aussi être à l’origine de ce type de lymphœdème.
Quels sont les signes d’apparition d’un lymphœdème ?
Le principal symptôme du lymphœdème est le gonflement de tout ou partie d’un membre ou d’une partie du corps. Par exemple, vos bijoux, vos vêtements vous serrent plus qu’à l’accoutumée. Il peut s’accompagner de douleurs, de sensations de lourdeur, des difficultés à vous mouvoir, des infections cutanées répétées. Votre peau peut devenir rouge, dure, tendue, plus épaisse ou même suinter. Elle laisse parfois apparaître des plis, voire des verrues.
En cas d’antécédents de cancer ou d’opération, vous bénéficierez d’une attention plus poussée dans les 5 années qui suivent votre prise en charge.

Il importe de rester vigilant, même des années après l’évènement à l’origine de la déficience du système lymphatique, et d’en parler à votre médecin aux moindres signes. Généralement, en cas de curage ganglionnaire pour un cancer gynécologique pelvien, le risque de lymphœdème apparaît environ 12 à 18 mois après les traitements. ”
Éléonore Piot - de Villars est praticienne en éducation thérapeutique et apporte son expertise en tant que patiente partenaire à l'Institut Curie.
Très engagée, Éléonore est également la Présidente de LYMPHOSPORT, une association dédiée à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lymphœdème et d'autres maladies chroniques par le biais de l'activité physique adaptée et de l'éducation thérapeutique. Elle est également active au sein d’IMAGYN, association de patientes atteintes de cancers gynécologiques pelviens (ovaire, col de l’utérus, endomètre).
Les stades d’évolution du lymphœdème
L’évolution d’un lymphœdème est classifiée selon le volume du membre affecté, la réaction de la peau au toucher et la texture de la peau. Cette classification permet d’adapter votre prise en charge, d’éviter la progression du lymphœdème et toutes complications.
Le stade 0, dit latent ou subclinique : le gonflement n’est pas visible malgré un dysfonctionnement du système lymphatique. Vous pouvez ressentir une fatigue, une lourdeur ou de légers picotements au niveau du membre affecté. Ce stade peut s’étaler sur plusieurs mois, voire quelques années avant l’apparition d’un lymphœdème.
Le stade 1, dit précoce : la lymphe commence à se stocker dans le membre affecté qui apparaît légèrement gonflé (20 % en plus qu’à l’ordinaire). Le lymphœdème peut être indolore. Une légère pression sur la zone concernée reste marquée ; c’est le signe du godet. Surélever le membre affecté permet d’atténuer le gonflement. Un traitement approprié permet de résorber le lymphœdème car les tissus ne sont pas durablement endommagés.
Le stade 2, dit avancé : le lymphœdème est plus étendu et le volume du membre affecté est plus marqué (20 à 40 % par rapport à l’ordinaire). Sa surélévation n’aide plus à le dégonfler. La peau s’épaissit et se durcit, elle montre des plis, des inflammations. Une pression sur la zone concernée s’estompe rapidement ; c’est le signe du godet négatif. À ce stade, le lymphœdème devient chronique. Il favorise les risques d’infections et d’un passage au stade 3.
Le stade 3, dit sévère : le lymphœdème est permanent et irréversible. Le membre affecté est particulièrement gonflé et difforme (plus de 40 % de sa taille initiale) et la texture de la peau prend un aspect de peau d’éléphant, d’où l’appellation « éléphantiasis ». La peau est ferme, voire dure (hyperkératose) et ne réagit pas au toucher. Elle peut se foncer et présenter des petites excroissances (vésicules, verrues lymphatiques).
Focus : différencier le lymphœdème d’un œdème des jambes
Alors que le lymphœdème est localisé (une jambe, un bras), l’œdème des jambes est bilatéral. Il résulte de l’accumulation d’eau, souvent lié à un problème cardiovasculaire. La peau reste fine, molle et n’est pas enflammée.
Quels sont les examens confirmant le diagnostic du lymphœdème ?
En cas de gonflement inexpliqué, même léger, d’une partie ou de l’un de vos membres, parlez-en à votre médecin. Cette consultation est d’autant plus justifiée si vous avez dernièrement subi une intervention chirurgicale, un traumatisme ou avez été traité pour un cancer.
Votre médecin va vous questionner sur vos symptômes, vos antécédents médicaux. Le membre affecté est examiné pour déterminer le stade d’évolution du lymphœdème : mesure, toucher (existence ou non du signe de godet), détection d’une éventuelle infection, etc. Il pourra aussi vous orienter vers un angiologue, spécialiste en médecine vasculaire.
AÉSIO mutuelle
Découvrez deuxiemeavis.fr, un service qui peut être inclus dans votre garantie AÉSIO mutuelle, pour bénéficier d’un second avis médical
Des examens complémentaires peuvent être nécessaires :
Un échodoppler, pour écarter la possibilité d’une maladie veineuse.
Un scanner abdominopelvien, en cas de lymphœdème au niveau des jambes ou des organes génitaux.
Une lymphoscintigraphie, afin de visualiser votre système lymphatique. Elle apporte des informations sur les ganglions et le drainage lymphatiques.
Toutefois, l'imagerie par résonance magnétique (« lympho-IRM ») est de plus en plus utilisée pour poser le diagnostic. Cet examen est plus efficace pour repérer un ralentissement de la circulation lymphatique et localiser l’obstruction.
AÉSIO mutuelle
Prise en charge des examens d'imagerie médicale
Vous souhaitez en savoir plus sur la prise en charge de vos examens d’imagerie médicale ? Cliquez ici pour en savoir plus.
Quel traitement pour un lymphœdème ?
Il n’existe actuellement pas de traitement curatif d’un lymphœdème. Sa prise en charge est adaptée au stade d’évolution du lymphœdème et compte deux phases distinctes : la phase intensive puis la phase d’entretien.
En phase intensive, l’objectif du traitement est multiple : réduire le gonflement, empêcher toutes aggravations qui pourraient engendrer des complications infectieuses et préserver autant que possible votre autonomie. Pour ce faire, de multiples mesures appelées physiothérapie décongestive combinée sont mises en place. Cette thérapie, réalisée par un kinésithérapeute, comprend le drainage lymphatique manuel (DLM) et le bandage de la partie du corps atteinte d'un lymphœdème. Vous devez alors être hospitalisé, être pris en charge en ambulatoire ou dans un centre de référence spécialisé dans la prise en charge des lymphœdèmes.
La phase d’entretien a pour objectif de maintenir le volume de votre membre obtenu lors de la phase précédente sur un long terme. Le port quotidien de bas ou de manchons de contention, voire des vêtements compressifs sur mesure est recommandé.
Lors de ces deux phases, Éléonore Piot – de Villars précise que « vous êtes pris en charge par une équipe pluridisciplinaire : votre médecin traitant, un angiologue, un kinésithérapeute, un pharmacien orthopédiste, un diététicien qui vous donne des conseils pour adopter une alimentation saine et éviter de prendre du poids ou en perdre si nécessaire. Vous pouvez aussi rencontrer un enseignant en éducation physique adaptée qui peut vous proposer des activités physiques ajustées à votre situation. Compte tenu de la lourdeur des traitements et le retentissement sur votre qualité de vie, vous pouvez vous faire accompagner par un psychologue. »
Éléonore Piot – de Villars ajoute que « votre médecin peut aussi vous prescrire des cures thermales spécialisées qui s’étalent sur trois semaines. Elles proposent des programmes d’éducation thérapeutiques qui offrent cette prise en charge pluridisciplinaire. Outre les moments de drainage, bandage, compression, ces cures vous permettent de pratiquer des activités physiques. Ce sont aussi des moments de partage et de possibilité d’échanger lors de groupes de parole. »
AÉSIO mutuelle
Le remboursement de votre cure thermale
Et si votre cure thermale pouvait être prise en charge ? Faites le point sur vos droits en quelques clics.
En outre, la peau du membre affecté par un lymphœdème est fragilisée. Il importe donc de l’hydrater, mais aussi de garder des ongles courts et propres.
L’éducation thérapeutique pour prendre soin de vous-même
« L’éducation thérapeutique permet à chacun de développer ou de renforcer des compétences pour gagner en autonomie, comprendre sa pathologie, l’intérêt du traitement et ainsi, mieux gérer sa maladie pour regagner en qualité de vie » explique Éléonore Piot – de Villars. Souvent coordonnée par un médecin, « dans le cas d’un lymphœdème, un kiné, une infirmière peuvent vous apprendre à réaliser un auto-drainage pour relancer la circulation de la lymphe et mobiliser le membre affecté. Ils peuvent vous montrer comment réaliser vos bandages, avec le matériel adapté, selon vos besoins, etc. Votre pharmacien orthopédique peut aussi être de bon conseil. »
Acquérir ces connaissances vous « permet de faire sauter certaines craintes : peur de complications, de douleurs. C’est important de se dire que je peux agir seule quand mon kinésithérapeute n’est pas disponible ! »
Trouver l’activité physique qui vous convient
« Ce qui est important est de réduire la sédentarité au quotidien pour se sentir mieux. Mais aussi de commencer par un échauffement et d’être progressif et régulier dans le temps. »
Éléonore Piot – de Villars a découvert les bénéfices de la marche nordique. « Et même si je ne marche pas rapidement, cette activité me permet de maintenir ma masse musculaire, de respirer, de bien placer mon corps pour permettre une vidange naturelle de mon système lymphatique. Toutefois, chacun fait ce qu’il peut et on ne parle pas de pratiquer un sport mais bien une activité physique. Ce peut être le jardinage, en se protégeant bien pour ne pas se blesser, faire des étirements, des assouplissements, de la marche comme aller à la pharmacie à pied, privilégier les escaliers aux escalators, etc. Certains peuvent aussi profiter des bienfaits de balades à vélo, faire du pilates, du yoga, etc. La natation permet de ne plus sentir la lourdeur du membre affecté, de se libérer quelques instants de son manchon et de ses bandages ; l’aquagym ou même l’aquabike peuvent être envisagées, etc.
Quelle que soit l’activité, il est important de demander l’avis de son médecin traitant. Pour apprendre les bons mouvements, il est bénéfique de se rapprocher d’une maison sport santé ou d’un enseignant en activité physique et bien sûr, d’en parler à son kinésithérapeute, premier entraîneur du patient. »
Et de conclure « qu’une activité physique peut faire gonfler les membres. C’est normal : un marathonien porte aussi des chaussettes de compression. Il faut donc porter son manchon ou ses bas de compression (ou de contention) sauf pour les activités nautiques. »
Des mesures préventives indispensables
« Selon la littérature scientifique, pour prévenir le risque d’apparition d’un lymphœdème (primaire et secondaire), il est important de garder une activité physique et de maintenir un poids équilibré. D’autres mesures sont parfois suggérées telles qu’éviter la chaleur et les voyages en avion. En cas d’obésité ou risque de surpoids, il importe d’adopter une alimentation équilibrée, en suivant notamment les conseils d’un diététicien. Dans tous les cas, au moindre signe, il faut consulter son médecin traitant ou même son kinésithérapeute. Plus tôt on agit sur un début de lymphœdème, plus il sera facile à prendre en charge. » précise Eléonore.
Prévaésio
Le service de prévention santé
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.